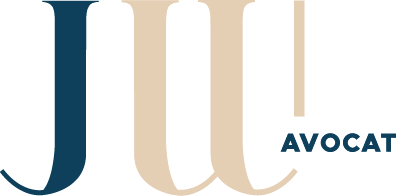La loi relative à la protection des enfants dite « Loi Taquet » du 7 février 2022 a significativement fait évoluer le droit de la protection de l’enfance.
Elle vise à répondre aux problématiques soulevées antérieurement lors de témoignages ou d’enquêtes par des enfants anciennement placés et à améliorer la vie des enfants protégés sur un plan affectif, matériel et physique.
Complété et modifié à plusieurs reprises au cours de son examen, la volonté de ce projet de loi était d’améliorer la situation des mineurs protégés, et même des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : interdiction des placements à l’hôtel, fin des sorties « sèches » à la majorité, meilleure protection contre les violences.
Il tend aussi à réformer la gouvernance nationale et le métier des assistants familiaux et comporte des avancées en matière de lutte contre diverses formes de maltraitances.
Les mesures relatées ci-après visent à améliorer les conditions de placement des enfants protégés (I), à mieux protéger les enfants contre les violences (II), à revoir les conditions d’exercice du métier d’assistant familial (III), à mieux piloter la politique de protection de l’enfant (IV), et enfin, à mieux gérer (et non protéger) les mineurs non accompagnés (V).
1. Mesures pour améliorer les conditions de placement des enfants protégés
La loi Taquet prévoit la recherche systématique de la possibilité de confier l’enfant « en danger » à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance (voisins ou amis connus).
L’enfant ne pourra être placé qu’après évaluation par les services de l’ASE des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement (art. 375-3 modifié du Code civil, art. 1 de la loi).
Le principe de maintenir les fratries ensemble est instauré (sauf si une autre solution est plus conforme à l’intérêt de l’enfant). L’article L. 223-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit qu’en cas de séparation d’une fratrie, l’ASE doit obligatoirement justifier sa décision et en informer le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures.
Lors du placement, le Président du Conseil départemental doit systématiquement proposer un parrain ou une marraine pour l’enfant, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine, afin d’établir une relation durable coordonnée par une association et sous le contrôle de l’ASE (Art. L. 221-2-2 du CASF). Toutefois, le parrainage doit recueillir l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale et il ne sera proposé qu’après une évaluation de l’intérêt de l’enfant et de la situation par l’ASE. Les personnes mineures non accompagnés (MNA) sont éligibles à ce système de parrainage.
Il doit également être systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par l’ASE de bénéficier d’un mentor à partir de l’entrée au collège. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel.
Le parrainage et le mentorat doivent être mentionnés dans le projet pour l’enfant.
Pour les enfants capables de discernement lors d’une audience ou de l’audition, un entretien avec le juge des enfants est systématique. (Art. 375-1 modifié du Code civil, art. 26 de la loi).
Le même article 375-1 du Code civil permet désormais au juge des enfants, si l’intérêt de l’enfant l’exige, de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.
Cette disposition comble un vide de l’article 1186 du Code de procédure civile qui enjoignait simplement au juge de rappeler à l’enfant, comme aux parents, leur droit à l’assistance d’un avocat sans lui donner le moyen juridique d’en faire désigner un pour l’enfant. Dans les faits, peu d’enfants sont assistés par un avocat lors des audiences d’assistance éducative, il est regrettable que le législateur n’ait pas suivi l’avis du Conseil national des barreaux mais aussi des associations qui ont pris position pour une assistance obligatoire des enfants dans les procédures d’assistance éducative, à l’instar de la présence obligatoire d’un avocat en matière pénale pour les mineurs.
La loi met fin aux « sorties-sèches » de l’ASE à la majorité de l’enfant. Ainsi, les 18-21 ans continueront automatiquement à bénéficier d’un accompagnement, même après avoir atteint la majorité. Un « droit au retour » à l’ASE pour les jeunes majeurs avant 21 ans est prévu, et ce, même si ces jeunes ont refusé à 18 ans de prolonger leur accompagnement ou s’ils n’en remplissaient plus les conditions (art. L 222-5 modifié du Code civil, art. 10 de la loi).
La loi prévoit la possibilité pour les mineurs émancipés d’être assisté par une personne de confiance lors d’un entretien obligatoire réalisé six mois après la sortie de l’ASE, avec le président du conseil départemental, pour faire un bilan de son accès à l’autonomie (art. L.222-5-2 modifié du Code civil, art. 17 de la loi).
2. Mesures destinées à mieux protéger les enfants contre les violences
Le contrôle des antécédents judiciaires est mis en place pour tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants dans des établissements pour mineurs. Ce système a été élaboré pour empêcher des cas de violences ou contact des mineurs avec des individus anciennement condamnés pour infractions sexuelles. Ces contrôles interviendront avant la prise de fonction des professionnels, mais aussi au cours de leur exercice (art. L.133-6 CASF).
Les établissements sociaux ou médico‑sociaux doivent désormais définir une politique de lutte contre la maltraitance et désigner une autorité tierce à l’établissement, vers laquelle les personnes accueillies pourront se tourner en cas de difficultés.
Dans tous les départements, les signalements des faits de violences (« informations préoccupantes ») s’effectueront obligatoirement sur un référentiel unique et partagé avec l’ensemble des départements pour s’assurer d’une plus grande qualité des signalements (art. l’article L. 226-3 du CSAF).
Au titre des fonctions de l’ASE figure aussi le soutien matériel, psychologique et éducatif à apporter à tout mineur qui se livre à la prostitution (art. 221-1 5° bis du CASF).
3. Mesures pour améliorer l’exercice du métier d’assistant familial
Des dispositions sont mises en place à l’égard des assistants familiaux afin qu’ils puissent exercer leur profession dans de meilleures conditions et que le métier soit exercé en toute légalité.
Sur le volet financier, la loi institue une rémunération minimale pour accueillir l’enfant, au moins égale au SMIC dès le premier enfant accueilli (art. L.423-30 du CASF article 28 de la loi).
Le département en tant qu’employeur doit assurer l’accompagnement et le soutien professionnel des assistants familiaux qu’il emploie. A cette fin, l’assistant familial doit être intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical.
Désormais, un assistant familial peut être autorisé à travailler au-delà de la limite d’âge posé dans la limite de 3 ans, afin de prolonger l’accompagnement d’un mineur ou d’un jeune majeur âgé de moins de 21 ans, après avis du médecin de prévention (Art. L. 422-5-1 du CASF, article 31 de la loi).
Il est prévu la création d’un fichier national des assistants familiaux afin de mieux contrôler les assistants familiaux exerçant dans plusieurs départements ou qui pourraient changer de département après un retrait d’agrément (art. L.147-14 du CASF).
4. Mesures destinées à mieux piloter la protection de l’enfant
La mise en place d’un organisme national unique sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles, afin de piloter au niveau national, la politique de protection de l’enfant. Ce groupement viendra coordonner et appuyer l’État et les conseils départementaux. Chaque année, il présentera au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel qui sera rendu public (art. L.147-13 du CASF, article 36 de la loi).
En outre, la loi prévoit au titre des mesures destinées à améliorer le pilotage de la protection de l’enfance :
- L’expérimentation dans les départements volontaires, de maisons de l’enfant et de la famille ;
- Le renforcement des services de protection maternelle et infantile (PMI) ;
- L’institution à titre expérimental et sur 5 ans de comités départementaux de la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’Etat dans le département. Ce comité va « coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance. » (Article 36 de la loi).
5. Mesures visant les mineurs non accompagnés (MNA)
La loi modifie les critères de répartition des mineurs étrangers isolés sur le territoire en prenant en considération les spécificités socio-économiques des départements, notamment leur niveau de pauvreté, et en valorisant ceux accompagnant les MNA au moment du passage de la majorité (art. L.221-2-2 du CASF, article 38 de la loi) ;
De manière assez surprenante, la loi traite dans une partie relative à la « protection des mineurs non accompagnés » de l’obligation pour l’ensemble des départements du recours au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité (AEM). Les départements devront transmettre chaque mois au préfet leurs décisions sur l’évaluation des personnes se déclarant MNA. Un refus d’un département entrainerait le retrait de la contribution forfaitaire versé par l’État (art. L.221-2-4 du CASF, article 40 de la loi).
Ce fichier vise notamment à éviter le « nomadisme administratif », c’est-à-dire à dissuader le détournement du dispositif de protection de l’enfance par de « faux mineurs » et de « lutter contre le nomadisme entre départements ». Toutefois, la Défenseure des droits a constaté à nouveau dans son rapport 2022 sur « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » que ce phénomène n’est toujours pas objectivé par les pouvoirs publics. Elle a déploré par ailleurs l’absence de tout bilan d’application dudit fichier par près de 80 départements, et l’objectivation d’une amélioration de la situation et a réitéré « son opposition à une procédure relevant bel et bien d’une gestion des flux migratoires dont devraient pourtant être exclus les mineurs non accompagnés ».